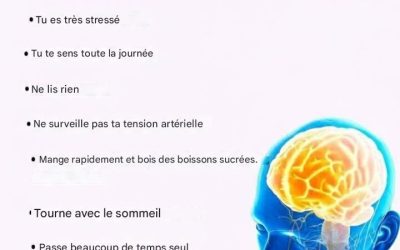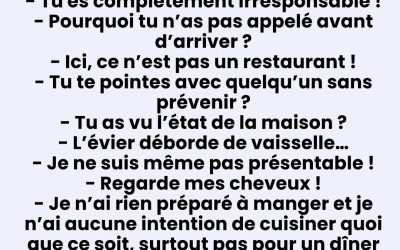Après la mort de mon mari, la maison que nous avions construite ensemble ne me semblait plus être un refuge.
Les pièces étaient identiques, pourtant tout semblait vide, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Pendant des mois avant son décès, nos journées avaient été rythmées par les couloirs d’hôpital, les résultats d’analyses et un optimisme prudent. Quand tout cela prit fin, le silence qui suivit fut plus lourd encore que la peur qui nous avait accompagnés jusque-là. À la douleur s’ajouta une vague de soucis pratiques : les frais médicaux impayés, les mensualités du prêt immobilier et la dure réalité de devoir tout gérer seule. Mon beau-fils de dix-neuf ans, Léo, vivait encore avec moi. Nous étions tous deux en deuil, mais nous luttions aussi chacun à notre manière, essayant d’imaginer un avenir auquel aucun de nous n’était préparé.
Un soir, épuisée et submergée, j’ai demandé à Leo de s’asseoir avec moi et de discuter.
Je lui ai expliqué combien il m’était devenu difficile de subvenir à tous les besoins seule et lui ai demandé gentiment s’il pouvait participer un peu au loyer pendant un temps. Il a souri et a éludé la question par une plaisanterie, disant que les choses finiraient par s’arranger et que je m’inquiétais pour rien. Dans mon état de fragilité, sa tentative de détendre l’atmosphère m’a paru maladroite plutôt que bienveillante. La déception a été plus profonde que je ne l’avais imaginé. Le lendemain matin, mon chagrin s’était mué en ressentiment, me persuadant qu’il ne comprenait pas la gravité de la situation. Animée par cette conviction, j’ai commencé à rassembler ses affaires, me préparant à lui demander de partir.